Actualités

Interview exclusive avec Raphaëlle Lacord, lauréate du prix Pierre-François Caillé 2024
Découvrez qui est Raphaëlle Lacord, lauréate du Prix Pierre-François Caillé de la traduction 2024 pour sa traduction de l'allemand de Trois âmes sœurs de Martina CLAVADETSCHER aux éditions Zoé, dans cette interview exclusive.
SFT – Comment êtes-vous devenue traductrice ? Quel chemin vous a mené à découvrir le monde de la traduction ?
Raphaëlle – Après mes études de lettres à Lausanne et à Paris, mon projet était de travailler dans l'édition. J'avais fait des stages à Paris puis à Berlin qui m'avaient d’ailleurs beaucoup plu. C’est lors d'un volontariat d’un an, dans le cadre d'un programme franco-allemand destiné à des futurs libraires et éditeurs, que j’ai été parachutée à Berlin. La maison d’édition m'a demandé de traduire du français vers l'allemand des essais sur Le Corbusier. J’ai donc commencé à traduire « dans le mauvais sens », comme on dit.
De langue maternelle française, je traduis désormais de l’allemand vers le français. Ayant fait toute ma scolarité au Luxembourg, j’ai appris à lire et à écrire en allemand, la première langue que l’on apprend à l’école.
Voilà pour ma première expérience de traduction éditoriale qui a eu le mérite de me mettre le pied à l’étrier et de me faire réaliser que la traduction était un chemin possible pour moi, même si je me suis juré de ne plus traduire dans ce sens-là, du français vers l’allemand !
SFT – Et ensuite, quel a été votre parcours ?
Raphaëlle – Je suis restée à Berlin et me suis installée en tant que traductrice indépendante. Pendant près de deux ans, j’ai travaillé principalement pour des institutions culturelles luxembourgeoises. Le Luxembourg, mon pays d'origine, a la particularité d’être trilingue avec, comme langues nationales, le luxembourgeois, le français et l’allemand. Ce multilinguisme favorise les traductions. Je traduisais pour des musées, des théâtres et des festivals d'art. Il s’agissait de mandats plutôt courts, de quelques semaines tout au plus.
J’ai ensuite appris l'existence du programme Georges-Arthur Goldschmidt, un autre programme franco-allemand, cette fois destiné aux jeunes traducteurs et traductrices. En 2015, j’ai participé à ce programme qui se déroule à Berlin et à Arles. C’est là que j’ai pu assister pour la première fois à des ateliers de traduction littéraire, et ce programme a été ma porte d’entrée dans ce monde.
SFT – Votre activité de traductrice littéraire occupe-t-elle désormais tout votre temps ? Ou exercez-vous également d'autres activités en parallèle ?
Raphaëlle – J’exerce d’autres activités en parallèle, même si la traduction occupe la majorité de mon temps, traduction qui n’est d’ailleurs pas exclusivement littéraire. Je viens par exemple de signer un contrat pour participer, en 2025, à la traduction d'un ouvrage universitaire sur le football féminin en Suisse. Pour ce projet, un collectif de traductrices s’est formé et je me réjouis de participer à cette aventure.
Je suis également responsable d’un programme qui s'appelle Écrire encore Suisse. Ce programme favorise l'inclusion d'écrivains et écrivaines venus d'ailleurs, en exil en Suisse. L’objectif est de mettre en relation ces auteurs et autrices avec des écrivains suisses pour leur permettre de continuer à écrire, d'avoir un pied dans la scène littéraire suisse, de participer à des lectures, et de publier leurs textes littéraires. C’est un travail d'accompagnement qui a pour vertu de me sortir du cadre parfois solitaire de la traduction.
SFT – Comment a débuté pour vous l’aventure de traduction pour Trois âmes sœurs ? S’agissait-il d’une proposition de votre part auprès de la maison d’édition ? D’une commande ?
Raphaëlle – La directrice du domaine allemand des éditions Zoé, Camille LUSCHER, qui est par ailleurs traductrice, m’a contactée pour me proposer de traduire un extrait de ce 2e roman de Martina CLAVADETSCHER qui venait de paraître et que je n’avais pas encore lu. J’avais lu son premier roman en allemand et l’avais beaucoup aimé. Je connaissais donc l'autrice, également reconnue en Suisse allemande pour ses textes de théâtre. Familière du style et de l’écriture expérimentale de Martina, je voyais donc de quoi il était question. J’ai commencé par lire le roman en allemand, puis j’ai traduit l’extrait, qui a été concluant. Voici comment tout a commencé.
SFT – Qu’est-ce qui vous a amenée à vous dire : « Je me lance dans ce projet de traduction » ?
Raphaëlle – Plusieurs choses. Tout d’abord, la proposition venant des éditions Zoé, une maison d’édition reconnue pour son excellent travail, tant par ses choix éditoriaux que par son accompagnement des auteurs et autrices, traducteurs et traductrices. Ensuite, la thématique féministe de l’ouvrage. Puis surtout, l’écriture, le style, le souffle de la langue de Martina CLAVADETSCHER, et le défi de traduction que posait ce texte avec ses nombreux retours à la ligne qui découpent la syntaxe des phrases et imposent un rythme.
SFT – Concernant ce défi de traduction, ces retours à la ligne respectaient-ils une logique particulière ou étaient-ils plutôt liés à un certain rythme donné au texte ?
Raphaëlle – Les deux. Ces retours à la ligne respectent la logique propre à l’autrice. Dans certains passages, ces retours accélèrent le rythme du texte pour créer une musique plus heurtée. C’est notamment le cas dans les chapitres du livre qui se déroulent dans une usine en Chine. Le rythme du texte reproduit le côté sériel de la fabrication des poupées à taille humaine. Le rythme est alors au service du sens du texte. Par ce découpage, l’autrice insiste, comme avec une virgule plus forte, sur les endroits où le lecteur s’arrêterait naturellement.
J’ai appris au fur et à mesure du processus de traduction à m’approprier cette logique. Au début du projet, et comme le texte n’est pas justifié (en bloc), il m’arrivait de ne pas savoir si un mot se retrouvait simplement rejeté à la ligne suivante, ou s’il s’agissait d’un retour à la ligne voulu par l’autrice. Mais après avoir traduit 100 pages du livre, je savais avec certitude s’il s’agissait d’un retour à la ligne intentionnel ou non. J’avais intégré le rythme du livre.
Le défi ensuite était de retranscrire ce découpage en français. Il fallait que le texte sonne aussi juste en français qu’en allemand. Dès le début, il y a eu un véritable contrat de confiance avec Martina qui m’a dit : « Fais-en ton livre. Approprie-toi le texte ». J’ai donc privilégié la syntaxe, le rythme et la musicalité propre au français dans le découpage opéré.
SFT – Cette traduction vous a-t-elle demandé de relever d’autres défis ?
Raphaëlle – Martina CLAVADETSCHER adore faire des liens, que ce soient des liens avec d’autres textes ou œuvres, ou bien, dans la grande majorité des cas, des liens au sein même du livre. Elle va par exemple utiliser un même mot à la page 3, à la page 36, puis à la page 142. En tant que lecteur/lectrice, on ne voit pas forcément ces liens, mais ce vocabulaire infuse inconsciemment notre lecture.
En tant que traductrice, je devais repérer ces liens et en rendre compte dans la traduction, car ils constituent les indices d’un véritable jeu de piste auquel nous invite l’autrice. Lors de la lecture, on évolue en eaux troubles. Qui sont ces trois femmes (ou pas femmes) ? Sont-elles humaines (ou non humaines) ? Aussi, un des grands enjeux de cette traduction a été de faire en sorte que les mots utilisés quelques pages plus haut dans une scène et qui reviennent quelques pages plus bas fonctionnent et soient les mêmes. De ce fait, il y a eu beaucoup d'allers-retours, et je me souviens encore qu’à la dernière relecture sur épreuve, j'ai découvert de nouveaux liens et allusions dont je ne m’étais pas aperçue jusque-là.
SFT – Vous souvenez-vous du nombre de versions et/ou relectures effectuées sur ce texte avant la version finale ?
Raphaëlle – Non… c’étaient des allers-retours incessants. Certains passages ont demandé beaucoup plus de travail que d'autres. J’ai traduit certaines phrases sans jamais les retoucher, tandis que d’autres ont connu une quinzaine de versions différentes. Pour donner un autre ordre de grandeur, cette traduction a été un compagnonnage de 6 mois, l’équivalent de 4 mois à temps plein. Disposer de suffisamment de temps est très important, notamment pour laisser reposer la traduction avant la dernière relecture sur épreuve. Cela permet d’avoir un regard plus frais sur les choses… et de repérer les derniers liens cachés !
SFT – On dit souvent que le traducteur/la traductrice d’un texte est le lecteur/la lectrice qui décortique et analyse le plus celui-ci, repérant erreurs, coquilles et autres incohérences. Cela a-t-il été le cas pour Trois âmes sœurs ?
Raphaëlle – Oui ! J’ai relevé quelques coquilles et incohérences qui n’avaient pas été repérées par l’autrice, et ce malgré les retours de nombreux lecteurs et plusieurs réimpressions du livre.
SFT – Quelle relation avez-vous entretenue avec Martina CLAVADETSCHER pendant la traduction de ce livre ?
Raphaëlle – Martina a été très disponible. Je l’ai tout d’abord contactée en début de projet pour me présenter. J’ai ensuite attendu d’avoir tout traduit et de rassembler toutes mes questions en suspens pour échanger avec elle. Nous avons eu une session de travail par téléphone, mais aussi des échanges plus sporadiques par e-mail. En général, la plupart des auteurs sont contents qu’on leur pose des questions détaillées sur leur texte, et c’était le cas de Martina qui s’est replongée avec enthousiasme dans son propre livre.
SFT – Un pire ou un meilleur souvenir de traduction à partager ?
Raphaëlle – Ce texte est pour moi très fortement lié à son rythme. Il y a eu bien sûr des trouvailles lexicales, l'impression d'avoir trouvé LE bon mot, mais la difficulté résidait avant tout dans la musique du texte. C’est quand j’avais le sentiment d’avoir réussi à rendre en français ce rythme de manière fluide, sur plusieurs paragraphes ou plusieurs pages, que j’étais vraiment satisfaite.
SFT – À ce titre, comment qualifieriez-vous le rythme et la musicalité de la langue allemande par rapport au rythme et la musicalité de la langue française, et en particulier dans ce roman ?
Raphaëlle – Ce que j’ai toujours trouvé frappant en allemand, et notamment dans Trois âmes sœurs, c’est la capacité de construction de cette langue. Les mots sont comme des cubes qui s’imbriquent les uns dans les autres et forment un tout. La construction du livre repose sur cette faculté de l'allemand à avoir des parties de phrase quasi-autonomes, et qui forment comme un socle pour le reste de la phrase. C’est une syntaxe très solide. Au niveau de la microstructure, du mot, c’est également le cas. L’allemand est très souple et peut accoler deux mots et créer ainsi des sortes de mots-valises, le tout de manière naturelle. C’est une langue ludique et extrêmement créative. En français, on ne peut pas accoler des mots les uns aux autres sans tomber dans une écriture très expérimentale. Il a donc fallu tirer parfois un peu sur la langue afin de rendre le français plus « construit », et faire tenir les différentes parties ensemble.
SFT – Quelle a été votre réaction lorsque vous avez reçu le prix Pierre-François Caillé de la traduction 2024, le 29 novembre dernier, dans l’auditorium de la Cité internationale de la langue française ?
Raphaëlle – Très heureuse et aussi très amusée de recevoir cette distinction trois ans après mon compagnon, Benjamin PÉCOUD, lauréat du prix PFC 2021 !
SFT – Et toujours pour les éditions Zoé. Une belle performance ! Et comment vous êtes-vous sentie après la remise définitive du manuscrit ?
Raphaëlle – Un grand sentiment de soulagement, de travail accompli, de libération aussi. Je me réjouissais de voir le livre paraître, pour qu’il ne m’appartienne plus et poursuive sa vie auprès des lectrices et lecteurs. Arrive aussi assez vite l’angoisse d'avoir mal fait, de vouloir changer tel ou tel passage… Ce moment est toujours ambigu, même si le sentiment principal reste une grande joie d'avoir porté ce texte pendant tout ce temps pour lui donner vie et lui permettre d’exister en français.
SFT – En conclusion, qu’aimez-vous le plus dans le fait de traduire, et notamment de traduire de la littérature ?
Raphaëlle – C’est de me plonger pendant plusieurs mois dans un texte. C'est essentiellement pour cela que j'aime traduire, je crois : pour vivre pendant une période donnée dans un monde parallèle fait d’une musicalité singulière.










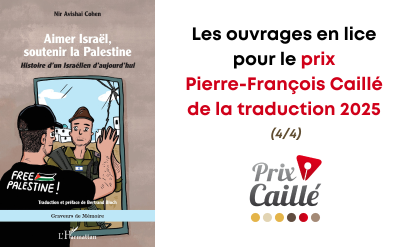
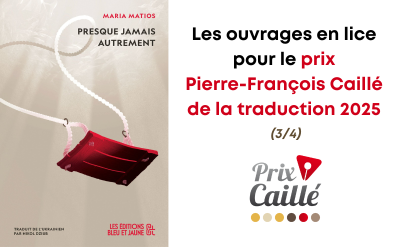

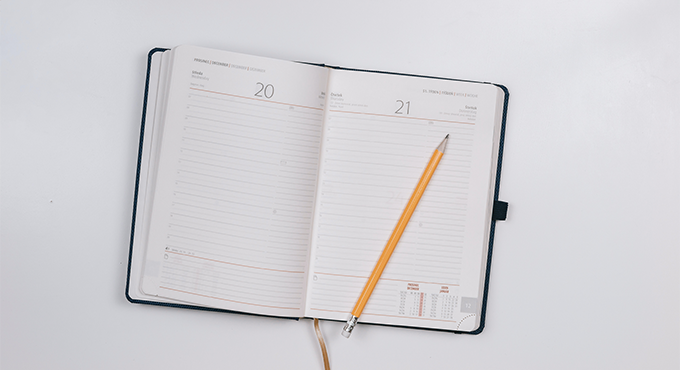


Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.